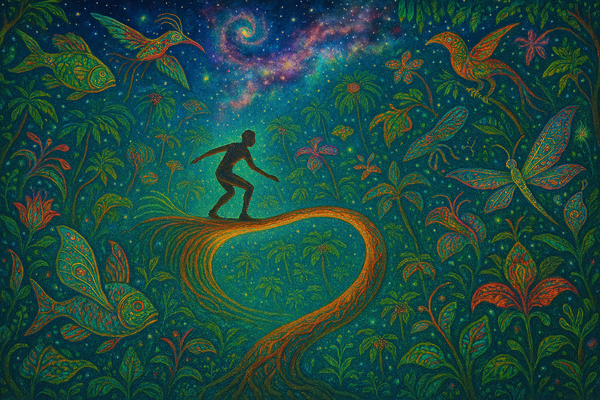Slow contre tous
Nous manquons toujours de temps. Beaucoup rêvent de journées un peu plus longues, trois ou quatre heures de bonus. La bonne idée serait peut être de savoir quoi soustraire.

Votre esprit est en apesanteur. Les idées se dessinent avec grâce et clarté. Une subtile énergie circule dans tout votre être. Entre vos mains, face à votre écran ou votre plan de travail, le temps semble s’être arrêté. Le temps n’existe plus. Vous êtes en état de flow.
Soudain, une notification met fin à cette élévation. Elle éclate d’abord votre bulle, puis vous tire par le bras. L’espace de travail profond que vous occupiez a disparu. Par nécessité, vous avez appris à compartimenter, optimiser de courtes plages de travail. Mais le subconscient n’a pas cette capacité. Alors, le tunnel de clarté s’effondre à l’intérieur. Une structure froide et saillante refait surface, chassant les flots ondulants de votre esprit. Les mails réapparaissent, les cases, les créneaux, les rendez-vous, les réunions. Le bestiaire acculé dans les coins de vos écrans chante à tue-tête. De son cor de guerre, le monde extérieur vous appelle, il n’a que faire de votre intime activité.
Le contraste est saisissant. Entre la clarté bienfaisante de notre espace-temps intérieur, et la grille structurée, digitalisée, compressée, imposée par les incessantes sollicitations, deux mondes luttent. Le temps lui-même se contracte et se détend, dans une amplitude vertigineuse.
Parmi les théories et découvertes qui ont façonné notre compréhension du monde, le temps reste une énigme. Nous avons su classer les atomes, décrire leur présence tangible autour de nous. Mais le temps, lui, demeure une abstraction, fixée arbitrairement comme référentiel. Interroger physiciens et philosophes sur ce sujet, c’est plonger dans un casse-tête qui se complique à mesure qu’on cherche à en saisir l’essence. Il ne s’agit pas seulement de mesurer son écoulement, variable selon notre vitesse dans l’univers, mais d’en comprendre la valeur profonde, le sens ultime.
Si l’univers avait une conscience, comment percevrait-il l’histoire de l’humanité ? Sans doute comme on remarque le vol d’un insecte qui nous frôle : au mieux avec curiosité, au pire avec indifférence ou agacement. Une fraction de seconde. L’insecte lui-même ressent-il ce vertige que nous éprouverions si l’on nous annonçait qu’il ne nous reste que 24 heures à vivre ? À l’opposé, si notre espérance de vie était de 200 ans, serions-nous attristés de mourir ou de voir un proche partir, à 90 ans ? Si ces expériences de pensée vous désorientent, c’est normal. Le passage et l’appréciation du temps sont sans doute l’énigme la mieux gardée de l’univers, et donc la plus intime.
À notre échelle, nous gardons malgré tout quelques repères communs. L’espèce humaine s’est développée sur les mêmes bases biologiques que le reste du vivant. Les saisons, le cycle du jour et de la nuit, à l’origine de nos rythmes circadiens, rythment toute la vie terrestre. Nous y sommes profondément ancrés, façonnés par eux autant que les autres espèces. Après des millions d’années d’évolution, nous y sommes parfaitement adaptés, et en réalité, indissociables — même si certains rêvent de s’en affranchir. Tandis que les animaux et les plantes semblent suivre le temps de façon instinctive, nous, humains, avons cette étrange impression d’en manquer sans cesse.
L’invention de l’électricité, et plus largement l’ensemble des technologies (transports et communications), nous permet aujourd’hui de défier artificiellement nos rythmes naturels. Jet lag et écran bleu, notifications et process froissent la photographie de l’instant présent. Il est important de noter que cette capacité à pirater nos rythmes biologiques reste très récente à l’échelle de l’évolution.
Le confort et le surplus artificiel de vie gagnés grâce à nos plus géniales inventions, comment les payons-nous ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, avons-nous appris. Il est difficile de croire que nous pouvons greffer du confort et du bien-être artificiel aux capacités réelles de notre biologie sans passer en payer un prix.
Les ultra-productifs obsessionnels ont poussé à l’extrême la gestion du temps, découpant leurs journées en créneaux de 15 minutes, chaque tâche calibrée au millimètre. Au moins, les figures du développement personnel s’accordent sur un point : le sommeil, lui, ne se compresse pas, sous peine de ruiner l’optimisation même de ces précieuses tranches d’excellence. La journée, telle qu’elle apparaît dans nos agendas, figée, découpée en plannings rigoureux, reste une invention arbitraire. Nombreux sont ceux qui prônent des heures de lever et de coucher constants. Mais que vaut cette vérité quand l’ensoleillement varie de plusieurs heures entre l’hiver et l’été ? Il semble plus logique que nos rythmes quotidiens suivent une courbe sinusoïdale, et non une ligne droite.
“En vérité, perdre ou gagner du temps ne change rien à cette sensation désagréable de courir après lui. ”
Au final, nous manquons toujours de temps. Beaucoup rêvent de journées un peu plus longues, trois ou quatre heures de bonus. Certains pestent quand ils en perdent, s’agacent à la moindre attente. Et pourtant, même si la journée durait 36 heures, cela ne changerait rien. L’avion nous fait gagner des jours entiers de voyage, mais qu’il ait deux heures de retard, et on a l’impression de gâcher notre journée. En vérité, perdre ou gagner du temps ne change rien à cette sensation désagréable de courir après lui. Tout ramène à notre impatience, notre lucidité, notre énergie, notre mental.
Alors, la faute à quoi ? Sollicitations, attentes, craintes et espoirs se noient dans la grande compétition organisée à l’échelle du monde. Tout est compétition. Même le capitalisme n’en est qu’un sous-produit. Conscients ou non, nous orchestrons cette lutte, nourrie par notre anxiété de la comparaison, version contemporaine de l’instinct de survie. Cette course nous enchaîne pieds et poings à la grande horloge qui régit notre quête de sens. Elle s’infiltre insidieusement dans nos vies privées, professionnelles, politiques. Lorsqu’un pays ralentit, l’ombre de l’envahisseur voisin s’étend : murmures de guerres commerciales ou géopolitiques. Entreprises rivales qui bataillent pour conclure un dossier ou conquérir un marché. “Winners take all.” Compétition encore, entre le passage à la caisse du supermarché et ce prochain rendez-vous de trop. Le temps manque. L’imprévu irrite, dans une journée déjà saturée.
Soyons tout de même reconnaissants de cette course mondiale. Ce mouvement de foule agit comme un moteur essentiel de notre confort quotidien. La performance est-elle contre nature, ou bien un phénomène vital, profondément ancré dans la sélection naturelle ? Des usines aux marchés financiers, de l’industrie alimentaire à l’intelligence artificielle, les chevaux sont passés de la calèche aux moteurs de Formule 1. Entre le rythme offert par la nature et celui imposé par la technologie, le décalage est flagrant. Et malgré tout, nous avons du mal à échapper à cette conscience tenace de notre finitude.
Être le premier, finir avant les autres, comporte des avantages certains à première vue. La rapidité a un impact indéniable sur notre sécurité et notre prospérité. Depuis toujours, il faut aller vite pour survivre : réunir ressources et protections, anticiper les menaces, qu’il s’agisse d’un virus ou d’un conflit. Le temps, c’est de l’argent. Et l’argent, le carburant de notre survie. Logique.
Nous travaillons pour cela, et nous pensons trop travailler. Vraiment ? Jetons un œil au progrès social en France, quelques dates à l’appui. Au début du XIXᵉ siècle, les ouvriers travaillaient jusqu’à 90 heures par semaine, dans des journées harassantes de 12 à 15 heures. La loi de 1892 limite ensuite le travail quotidien à 11 heures pour les femmes et les enfants, soit environ 66 heures hebdomadaires. En 1936, les lois du Front populaire marquent une avancée majeure avec la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés. La suite, vous la connaissez : 35 heures, 5 semaines de congés, les RTT. Un rythme aujourd’hui jugé étouffant par les partisans du slow living. Voilà de quoi à nouveau perdre la notion du temps… et avaler quelques couleuvres de plus. Mais non, cela ne suffit toujours pas. Nos grands-parents étaient-ils plus sereins les dimanches soir ? Sans doute subissaient-ils moins les frasques de notre accélération.
"Faire quelque chose de non productif peut devenir une source de stress."
Le sociologue allemand Hartmut Rosa a étudié cette notion d’accélération, corrélée à la croissance. Il explique que l’accélération est poussée par trois moteurs : le culturel, avec la quête de réalisation personnelle ; l’économique, sous la pression du capitalisme et de l’argent ; et le social, à cause des changements rapides dans nos modes de vie.
Dans ces conditions, faire quelque chose de non productif peut devenir une source de stress. Un simple tour à vélo doit justifier son utilité : compter les calories brûlées ou mesurer le capital de détente accumulé pour mieux replonger ensuite. Développement personnel et développement du compte en banque sont souvent les deux facettes d’une même pièce. Envisager moins de contraintes sur les heures de la journée, laisser plus de temps ouvert, libre, serait pourtant une solution radicalement efficace pour le bonheur de tous. Mais, pris dans le rythme de la société, qui tente sans cesse un dépassement par la droite, cela nous échappe. Nous courons après notre confort comme si notre vie en dépendait. Est-ce une bonne idée de rendre le travail optionnel, comme l’avait fait cette civilisation antique, dans le roman “La Nuit des Temps” de Barjavel ? Pour l’instant l’explosion technologique vise d’abord l’augmentation pure et dure de la productivité, même si nous devons reconnaître les améliorations sociales, contrebalancées par une concentration de certaines richesses. Mais l’augmentation de la productivité et du multitâche reste un objectif (ou un résultat) majeur de l’investissement technologique. Il est difficile de prédire la manière dont nous jugerons les conditions de vie et de travail d’un Européen du début de ce siècle, d’ici 200 ans. Peut-être nos petits-enfants feront-ils une moue de dégoût, voyant notre harnachement à la semaine de travail, du lundi au vendredi, ruinant huit bonnes heures de la journée.
Il existe quelques tentatives et idées intéressantes pour reprendre le contrôle de notre temps dans un environnement normé. Par exemple, le concept de slow freelancing, parmi les idées florissantes post-Covid, résonne comme un symbole de libération à double sens : se détacher de l’entreprise et du chronomètre qui l’accompagne. La philosophie est séduisante. Mais l’idée reste difficile à vendre si l’on souhaite séduire son marché. Dans ce monde, soit on s’offre de la détente, soit on vend de la productivité. Vendre de la productivité en toute détente est un repoussoir pour l’acheteur, le patron, ou pour quiconque serait impacté matériellement par votre rendement. En réalité, cette notion relève presque du tabou. Si vous gagnez bien votre vie en 15 heures de travail par semaine, c’est très bien, mais restez discret. Ce n’est pas vraiment vendeur sur LinkedIn, au sens de votre efficacité, et sûrement de votre crédibilité.
Le mal qui habite beaucoup de gens ne réside pas forcément dans le fait de trop travailler, mais dans la manière dont nous vivons ce temps de travail. Et plus largement, dans notre rapport au temps lui-même. Ce que nous appelons manque de temps est peut-être un manque de connexion à ce qui nous permet de l’oublier. Une perte de résonance avec ce que nous faisons, les personnes que nous aimons, et les rythmes naturels. En ralentissant, non pour fuir, mais pour savourer, pour habiter pleinement chaque instant, nous pourrions redécouvrir une qualité du temps qui nous échappe. Après tout, ce n’est pas l’abondance d’heures qui compte, mais ce que nous en faisons, ou plutôt comment nous les vivons.
Trouver son rythme ne devrait pas être un petit avantage négocié, puis dissimulé avec malaise dans un coin. Il devrait être au centre de tout. Le monde réclame la vitesse de la fibre optique et des avions, mais rappelez-vous qu’un proverbe berbère dit : « L’âme ne voyage jamais plus vite qu’à dos de chameau. » Portez votre regard vers la spiritualité, et constatez que le bonheur semble appartenir à ceux qui savent simplement s’asseoir et filtrer leurs pensées. Ainsi, ils contemplent la véritable douceur du temps et du monde. Dans les bonnes conditions, le confinement, mirage du ralentissement, a soulagé de nombreuses personnes, heureuses d’apprécier le temps sans que celui-ci ne toque à leur porte (autre sujet un peu tabou).
Cette réflexion semble être une incitation à l’oisiveté, mais il n’en est rien. L’espérance et le niveau de vie moyen que l’humanité a atteints au XXIᵉ siècle grâce à ses obsessions et son acharnement forcent le respect (lisez Factfulness de Hans Rosling). Penseurs, entrepreneurs et travailleurs ambitieux de ce monde ont toujours été des sources de motivation à juste titre. Mais leur abnégation est souvent mal interprétée. Ralentir, ou plutôt se recentrer, peut aussi signifier se donner corps et âme dans une tâche qui nourrit notre vision du monde. En trouvant votre ikigai, ce principe japonais de vie alignée, vous pourriez rester occupé 15 heures par jour avec légèreté et renouer avec le flow.
La qualité de l’instant a valeur d’infini dans un monde où les heures défilent comme des automobilistes pleins phares sur votre route. Miles Davis disait : « Ce ne sont pas les notes que je joue qui sont importantes, mais celles que je ne joue pas. » Ainsi, dans un quotidien épanoui, les choses inutiles que nous sommes capables de soustraire ne peuvent qu’embellir ce qui nous reste à apprécier. Nous pouvons alors nous délecter de moments en pleine conscience. Qui donc préfère faire trois choses dans l’urgence plutôt qu’une seule en pleine conscience ? Ralentir, égrainer consciemment le temps, c’est économiser notre énergie — cette fameuse énergie si précieuse à l’avenir de notre humanité. Dans l’idée de ralentir se niche une solution tellement évidente qu’elle sonne comme une insolence. Si la qualité de vie peut s’améliorer de la sorte, pourquoi en serait-il autrement de la qualité de notre travail ?
Quand on prend le temps, flirtant avec son évanescence, on ne cherche plus à posséder les choses, la situation ou l’instant. Tel un plongeur dans le calme profond de l’océan, on entre en résonance avec ce qui est là, offrant en écho une danse lente et respectueuse dans l’apesanteur des flots. Conscients de cette vie suspendue à notre souffle. Le souffle est notre premier signe de vie, et le dernier. C’est bien lui qui nous donne le véritable tempo. Alors soufflez, respirez, et gardez en tête d’observer le monde à ce rythme, car il n’est pas possible d’aller plus vite.
Livres évoqués dans cet article :
Harmut Rosa - Accélération: Une critique sociale du temps
René Barjavel - La Nuit des temps
Hans Rosling - Factfulness